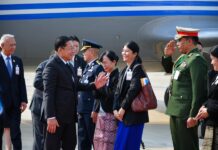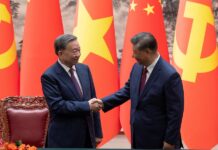Jamais vraiment remise de la décision de la Cour Internationale de Justice d’avoir attribué la souveraineté du temple au Cambodge, la Thaïlande ne reconnaît pas le tracé de la frontière autour de Preah Vihear. Derrière l’enjeu stratégique très relatif de ce bout de terrain d’un peu plus de quatre kilomètres carrés se cachent des camouflets historiques et des facteurs politiques contemporains qui exacerbent la fibre patriotique des deux côtés.
Suspendues à une corde qui longe la chaussée face au Palais du gouvernement, des cartes plastifiées montrent les frontières du Siam sous les différents souverains de la dynastie Chakri.
Une large banderole interroge : « Comment les Cambodgiens peuvent-ils nous voler notre territoire ? ».
Des hommes et des femmes émaciés, portant l’uniforme austère de coton bleu de la secte bouddhiste rigoriste Santi Asoke, vont et viennent autour de tentes de camping plantées dans le bitume.
Depuis début janvier, quelques centaines de ces militants nationalistes thaïlandais, membres pour beaucoup du Réseau des Patriotes Thaïs, ont installé leurs quartiers près du bureau du Premier ministre Abhisit Vejjajiva, qu’ils accusent de « brader la souveraineté nationale ».
L’un d’entre eux, Kaenfa Senmuang, dit venir de Kantharalak, un district frontalier proche du temple khmer de Preah Vihear, et savoir de quoi il parle.
« Ce gouvernement dit que le pays n’a pas perdu de territoire au profit du Cambodge. Mais les gens qui vivent sur la frontière comme moi, nous nous faisons régulièrement expulser de nos terres. Les terres que nous avions l’habitude de cultiver, nous ne pouvons plus y aller depuis que le Premier ministre Abhisit dirige le gouvernement. Nous ne pouvons même plus y aller cueillir des champignons. Et elles sont désormais occupées par des Cambodgiens », affirme l’homme aux mâchoires puissantes, typiques des Thaï-Khmers de cette région.
En regardant la situation froidement, la question du temple de Preah Vihear et de la zone de 4,6 kilomètres carrés qui l’entoure – zone revendiquée par la Thaïlande et le Cambodge – est une simple question juridique et technique d’abornement des frontières.
La Cour Internationale de Justice a rendu un arrêt en juin 1962 tranchant une fois pour toutes le litige.
Un comité conjoint khméro-thaï travaille à la délimitation des frontières depuis plus de dix ans.
Mais des questions de fierté nationale blessée, d’humiliations mal digérées, de tensions politiques internes et d’intérêts économiques s’y mêlent pour faire de ce litige un contentieux inextricable et potentiellement dévastateur.
« Notre inquiétude est tout simplement que cela ne dégénère en une guerre réelle », confiait fin février un diplomate européen.
Avanies historiques
Pour essayer de comprendre l’attitude thaïlandaise sur la controverse, un détour historique s’impose.
Comme l’a démontré Thongchai Winichakul dans son livre Siam Mapped (1), le nationalisme thaïlandais s’est essentiellement bâti comme une réaction aux « humiliations territoriales » subies au début du XXème siècle face aux puissances coloniales britannique et, surtout, française.
L’incident de la Pak Nam, en 1893, lorsque deux canonnières françaises remontant le Chao Phraya forcèrent Bangkok à signer un traité cédant des territoires sur la rive droite du Mékong, les traités de 1902 (cession de trois provinces au Cambodge alors protectorat français) et de 1907 (cession des provinces du Sud à la Malaisie britannique) ont marqué à vif la conscience collective des élites du pays.
De là, la volonté de « ne plus jamais céder un pouce de territoire ».
Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande était revenue, grâce à son alliance avec le Japon, sur tous les traités passés avec la France et avait pu récupérer les territoires cédés auparavant.
Mais la défaite de l’axe avait rétabli, en 1946, le statu quo ante bellum, ce qui n’avait guère empêché les troupes thaïlandaises d’occuper le temple de Preah Vihear dès 1949.
« Pour toute une génération, la perte des trois provinces (Battambang, Sisophon et Siem Reap) après la Seconde Guerre mondiale a été un symbole d’oppression et d’humiliation », explique l’architecte thaïlandais Sumet Chumsai.
Le découplage
L’arrêt de la Cour Internationale de Justice de 1962 a été une cruelle surprise pour les Thaïlandais, qui étaient persuadés d’avoir le « bon droit » pour eux.
Une intense campagne nationaliste avait été orchestrée dans les mois précédant le jugement, avec des appels aux contributions financières des Thaïlandais et des chansons de propagande diffusées en boucle par les radios.
Le choc émotionnel provoqué par la décision de la Cour fut énorme.
« Les Thaïlandais de Bangkok de cette époque se souviennent du jour du jugement et de la perte du temple, de la même manière que les Américains se souviennent du jour de l’assassinat de Kennedy », affirme l’historien Chris Baker.
Beaucoup dans l’élite évoquent encore une « erreur tactique » de l’équipe d’avocats qui était menée par M.R. Seni Pramoj, futur Premier ministre et l’un des fondateurs du Parti Démocrate.
Et ce n’est que sous les fortes pressions américaines que le gouvernement de Sarit Thanarat s’était résigné à accepter la décision de la Cour.
L’arrêt est pourtant limpide.
Dans les considérants menant au jugement, la Cour indique « s’estimer tenue de se prononcer en faveur de la frontière indiquée sur la carte (dite de l’annexe 1) pour la zone litigieuse ».
Cette carte, établie par un comité mixte franco-siamois en 1908, place la zone de 4,6 kilomètres carrés en territoire cambodgien.
Le jugement ne porte, lui, que sur le temple qui, dit la cour, « relève de la souveraineté cambodgienne ».
C’est sur ce point précis que les interprétations des gouvernements thaïlandais et cambodgien divergent.
Pour le Cambodge, la cour a affirmé la validité de la carte et donc du tracé de la frontière qui y figure.
La Thaïlande a, elle, établi une distinction entre le jugement et ses considérants.
« La manœuvre est limpide : en séparant l’arrêt de ses considérants, on nie toute valeur à la carte annexée et on peut remettre en cause tout le tracé frontalier », explique Raoul M. Jennar, consultant et auteur d’une thèse sur les frontières du Cambodge.
Un petit chez les grands
D’autres facteurs, moins tangibles, interviennent, comme l’ambivalence de la relation qu’entretiennent les Thaïlandais avec les Cambodgiens.
Bien qu’une grande partie de la culture thaïlandaise, de la langue à l’architecture, ait subi l’influence de la civilisation khmère, certains thaïlandais tendent à considérer les Cambodgiens comme des sortes de « cousins pauvres », un peu sauvages et indignes de confiance.
« Pour les Thaïlandais, il est tout simplement difficile d’admettre qu’un pays plus pauvre ait pu bâtir une grande civilisation comme Angkor », estime Puangthong R. Pawakapan, une spécialiste thaïlandaise du Cambodge.
Pétris de moralisme et de nationalisme, les manuels scolaires reflètent ces préjugés.
« Nous avons été éduqués, socialisés au moyen de livres scolaires remplis de préconceptions sur l’histoire, particulièrement sur l’histoire des pays voisins », reconnaît l’historien Charnvit Kasetsiri.
Une volonté de « siamiser » la culture khmère a prévalu jusqu’à récemment, comme en témoigne la création, dans la nomenclature archéologique thaïe, du « style architectural de Lopburi », lequel permettait d’évoquer les temples khmers de Thaïlande sans utiliser le mot « khmer ».
L’approche cambodgienne se fonde, elle, avant tout sur l’arrêt de 1962.
Le pays n’a guère l’habitude d’être vu comme le « bon élève » par la communauté internationale et il ne se prive pas de jouir de l’occasion.
« Ils ont le droit international de leur côté. C’est assez émouvant pour eux, ils ont l’impression de pouvoir jouer dans la cour des grands, de pouvoir aller à l’ONU pour défendre leurs biens eux-mêmes », estime Jérémy James, expert du Cambodge et directeur adjoint de l’Institut de recherches sur l’Asie du Sud-est contemporaine (Irasec) (2), basé à Bangkok.
Après être sortis de trois décennies de conflit, les Cambodgiens souhaitent pouvoir développer leurs atouts touristiques, parmi lesquels Preah Vihear fait figure de pièce-maîtresse du fait de sa situation sur une ligne de crête et de son style architectural raffiné.
L’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2008, pleinement soutenue par le gouvernement thaïlandais de l’époque, avait été célébrée avec fierté.
Avant cette inscription, un plan de zone tampon entourant le temple et nécessaire pour l’exploitation touristique comme site du Patrimoine mondial, avait été établi par Phnom Penh et modifié plusieurs fois en fonction des demandes des gouvernements thaïlandais de Surayud Chulanont (2006-2007) et de Samak Sundaravej (2007-2008).
La version finale du plan avait été visée par les experts du ministère thaïlandais des Affaires étrangères.
Il n’y avait donc aucun élément du dossier présenté en 2008 par Phnom Penh à l’Unesco qui n’était pas connu des autorités thaïlandaises de l’époque.
Alors qu’il était encore dans l’opposition, Abhisit Vejjajiva avait déjà dénoncé les « concessions excessives » du gouvernement thaïlandais, une position qu’il a maintenue une fois devenu Premier ministre en décembre 2008.
Peut-être est-ce là une indication de l’influence énorme qu’ont regagnée les militaires depuis le coup d’Etat de septembre 2006 ?
Trois entités en Thaïlande n’ont jamais accepté la décision de la Cour internationale sur le temple : l’armée, le ministère des Affaires étrangères et le Parti Démocrate (à cause, en partie, de l’humiliation subie par le fondateur du parti, Seni Pramoj, qui a défendu la position thaïlandaise devant la Cour).
Certains y voient un lien avec l’élection prévue, en principe au premier semestre de l’année.
« En 2007, les militaires ont appris qu’ils ne pouvaient pas gagner une élection grâce à l’intimidation et l’argent. Et ils ne veulent pas qu’un mouvement pro-Thaksin gagne les élections. Peut-être alors ont-ils besoin d’une crise, peut-être que les seules circonstances dans lesquelles le rêve d’un « gouvernement national » serait acceptable est un état de guerre », estime Chris Baker.
ARNAUD DUBUS
(1) Siam Mapped. A history of the Geo-Body of a Nation, par Thongchai Winichakul, Silkworm Books, 1995, Chiang Mai
(2) Lire à ce sujet : L’asie du Sud-est 2011. Les événements majeurs de l’année (pp 134-136)
Publication de l’Irasec, sous la direction de Arnaud Leveau et Benoît de Tréglodé Les Indes savantes, Paris, 2011