
Une chronique géopolitique de Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande
Le second mandat du Président Donald Trump et le système des Nations Unies
Remarques introductives
L’investiture du second mandat du Président Donald Trump, largement médiatisée dans le monde entier, a suscité des questions dramatiques non seulement dans l’esprit des diplomates des 193 États membres de l’ONU, mais aussi dans toute la famille du système des Nations Unies, composée d’agences spéciales. Les raisons de ces interrogations sont parfaitement convaincantes. L’annonce du retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Accord de Paris sur le changement climatique ne représente que le début d’un profond changement du multilatéralisme déjà engagé dans un déclin dangereux.
A l’échelle de l’histoire universelle de la diplomatie multilatérale, cette annonce n’est pas une première. Les États-Unis se sont déjà retirés de l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1977 en raison de préoccupations concernant la politisation de l’OIT, ses préjugés contre les économies de marché et l’influence des États communistes. Ils y sont revenus en 1990 après des réformes au sein de l’OIT. En 2018, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont décidé de se retirer de l’UNESCO, l’accusant d’être partiale à l’égard d’Israël et de mal gérer les fonds. Les États-Unis ont rejoint l’UNESCO en 2023 après des réformes visant à remédier à la situation des inquiétudes des États-Unis ont eu lieu.
Le 20 janvier 2025, les États-Unis ont annoncé leur intention de se retirer de l’OMS.
La lettre présidentielle adressée au Secrétaire général des Nations Unies, signée le 20 janvier 2021, qui rétractait la notification de retrait des États-Unis du 6 juillet 2020, a été révoquée.
Dans les développements récents, le Président Donald Trump a pris des mesures importantes affectant les Nations Unies et ses agences spécialisées : le 23 janvier 2025, les Nations Unies ont confirmé que les États-Unis quitteraient l’OMS le 22 janvier 2026. Le Président Trump a critiqué l’OMS pour sa gestion des crises sanitaires internationales, ayant conduit à cette décision. Les États-Unis, en tant que plus grand contributeur financier de l’OMS, doivent donner un préavis d’un an et régler leurs cotisations avant que le retrait ne devienne effectif.
Le 27 janvier 2025, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté les États-Unis : d’envisager davantage d’exemptions dans sa pause de 90 jours sur l’aide étrangère. Cette pause, initiée par le Président Trump pour revoir l’alignement des contributions d’aide sur celles des États-Unis, la politique étrangère pourrait potentiellement bloquer des milliards d’aides vitales. L’ordonnance concerne toute l’aide étrangère existante et nouvelle, avec des exemptions autorisées par le secrétaire d’État Marco Rubio, y compris pour l’aide alimentaire d’urgence.
Vers une réforme fondamentale ?
Toutes les actions mentionnées ci-dessus reflètent la position critique du Président Trump à l’égard des institutions existantes de l’ONU et les efforts de son administration pour réévaluer la position des États-Unis d’implication dans les organisations internationales.
Une réforme fondamentale du système des Nations Unies est nécessaire de toute urgence, mais sa mise en œuvre est un processus extrêmement complexe et il serait irréaliste de tenter de prédire exactement ce qui pourrait être accompli dans la pratique au cours du deuxième mandat du Président Donald Trump. Pourquoi ?
Plusieurs facteurs clés doivent être pris en considération :
Tout d’abord, une réforme substantielle de l’ONU nécessite un large consensus parmi ses 193 États membres, dont beaucoup ont des intérêts contradictoires. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (P5) disposent d’un droit de veto, ce qui rend les changements structurels – en particulier ceux liés à la prise de décision – extrêmement difficiles.
L’ONU est une grande organisation bureaucratique dotée de structures et de traditions bien ancrées. Les efforts de réforme se heurtent souvent à une résistance importante de l’intérieur, ainsi que de la part d’un certain nombre d’États membres qui bénéficient du statu quo existant.
L’ordre mondial actuel est marqué par une concurrence croissante entre les grandes puissances, en particulier les États-Unis, la Chine et la Russie. Ces divisions compliquent les négociations actuelles et futures sur la réforme de l’ONU, car tout changement proposé pourrait être perçu comme favorisant un bloc par rapport à un autre.
Bien que l’administration du président Donald Trump ait été très critique à l’égard des institutions multilatérales, en particulier de l’ONU, au cours de son premier mandat, on ne sait pas encore si le second mandat de Trump donnerait la priorité à la réforme de l’ONU de manière constructive. Son approche répétée de « l’Amérique d’abord » était souvent en conflit avec les structures de gouvernance mondiale. Le second mandat pourrait soit renforcer le scepticisme attendu, soit simplement rechercher des réformes sélectives alignées sur les grandes orientations du gouvernement américain.
Même si Donald Trump est en faveur de grandes réformes de l’ONU, la dynamique politique intérieure, les priorités économiques et les crises internationales pourraient modifier l’orientation de son administration. En outre, d’autres acteurs mondiaux, tels que la Chine, l’UE et les puissances émergentes comme l’Inde et l’Indonésie, joueraient un rôle essentiel dans l’élaboration ou le blocage de toute réforme proposée.
Conclusion
Compte tenu des complexités actuelles, prédire l’ampleur des réformes possibles de l’ONU sous la seconde administration de Donald Trump reste dans une large mesure spéculatif. Il faudra attendre le discours de Donald Trump lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025. Si certains changements progressifs peuvent être envisagés, une transformation radicale du système des Nations Unies restera probablement hors de portée.
De nombreuses séries de négociations devraient avoir lieu prochainement aux niveaux bilatéral, régional, mondial et au sommet. Si elles sont menées de bonne foi, avec une volonté de parvenir à des accords mutuellement bénéfiques, elles pourraient jouer un rôle clé en aidant la communauté internationale à traverser avec succès la période actuelle, marquée par des vulnérabilités, des incertitudes et des ruptures à l’échelle mondiale.
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.






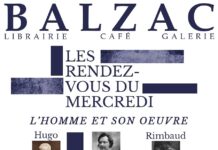
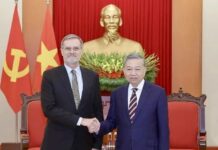





La réforme du système onusien que le Général De Gaulle avait qualifié, en 1960, de « Machin ô combien inutile et dangereux », est un topos pour les étudiants en droit et relations internationale. Étudiant en 1965, nous en faisions un de nos exercices rhétoriques, une de nos joutes oratoires : Pour, Contre, Pourquoi, Comment…
Au fur et à mesure du processus de décolonisation, les États membres devinrent de plus en plus nombreux. Et dans le cadre de la « guerre froide » qui débute au lendemain de la guerre de Corée (non terminée faute d’armistice), l’Union Soviétique, rallie à son panache les nouveaux États, même si ceux-ci se déclarèrent « non alignés » (conférence de Bandung). Les majorités et soutiens conquis par l’Union Soviétique, leurs oppositions aux États-Unis et leurs soutiens (cas particuliers de la France surtout au regard de l’OTAN, bras armé de l’ONU) conduirent au blocage des institutions onusiennes et particulièrement le Conseil de Sécurité, l’organe actif, décisionnel et opérationnel en cas de « menaces contre la paix » ou de « rupture de la paix ». La résolution Dean Acheson en fût l’expression éclatante en 1950 (résolution 377 « Union pour le maintien de la paix » connue sous le nom de résolution Acheson). Un arrangement fût inventé pour substituer l’assemblée générale au Conseil de Sécurité paralysé.
Depuis, le phénomène n’a fait que croitre et embellir pour conduire à une paralysie du système. Les interventions militaires furent décidées en dehors du système (Yougoslavie) ou au delà de ce que le conseil autorisait (Libye) et dans le cadre d’interprétations de la Charte contestées.
Dans ces conditions délétères, les deux protagonistes majeurs conjuguèrent leurs efforts dans le processus de paralysie. La Chine, par la suite, mit son grain de sel dans l’engrenage. La France, elle, ne se contenta, sa position défendue le 14 février 2003 au Conseil de Sécurité sur la deuxième guerre du golfe « exceptée, à assister, impuissante à l’évolution ».
La chronique rappelle l’importance des agences dont la paralysie est à l’image des organes centraux même s’il faut nuancer. Beaucoup d’observateurs soulignent leur utilité dans le cadre des programmes d’aides en particulier. Leur efficacité est largement obérée par un phénomène de bureaucratisation et d’impuissance sur lequel la chronique insiste. Une bureaucratie coûteuse, impuissante dans l’action et, aux yeux des principaux contributeurs que sont les USA, partiales. A la suite des retraits énumérés dans la chronique, il faut ajouter l’UNRWA agence ad hoc chargée spécialement des réfugiés palestiniens, et dont le financement américain (avec d’autres mais rétablis depuis) a été suspendu, suspectée, au vu du constat (contesté notamment dans le rapport Colonna) selon lequel certains de ses agents auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
La réforme « phare » réclamée par la majorité des « nouveaux » États (membres après 1960) concerne le Conseil de Sécurité et ses 5 membres permanents dont le statut « immuable », « permanent », remonte à la seconde guerre mondiale et à un état des relations internationales totalement modifié depuis. A part la Chine, pays en voie de développement à l’époque ne l’est plus et aucun pays du « Sud » n’y figure. Les prétendants sont nombreux à commencer l’Inde ou le Brésil, mais aussi l’Afrique du Sud et le Nigeria, représentant des continents non actuellement représentés. Plutôt que de remettre en cause une place « éternelle » des membres actuels, c’est une réforme par la voie de l’élargissement qui est avancée, la seule voie possible puisque toute réforme suppose l’unanimité, chacun des 5 membres permanents disposant d’un droit de veto.
La place de la France et du Royaume-Uni (lorsqu’il était membre de l’UE) est d’ailleurs contestée et d’abord par l’Allemagne, plus peuplée, plus puissante, ayant quitté son « statut » de « nain politique » après la réunification de 1990 et bien que non dotée de l’arme nucléaire. Faute de pouvoir faire avancer un tel dossier, il est parfois préconisé un statut de membre permanent pour l’Europe, que la France n’est pas prête d’accepter même si elle s’affiche comme leader d’une « Europe puissance »… mais sans doute pilotée et chapeautée par elle…
Cette ambition française et celle de nombreux autres États suscitent à chaque fois des imbroglios qui surgissent de toutes parts lorsque la réforme de l’ONU est abordée, et elle l’est constamment et conduisent à renforcer les blocages et renforcer le statut d’un système que les « bénéficiaires » de 1945 ne sont pas prêts à modifier ni abandonner en dépit des critiques qu »ils peuvent lui porter.
Le Président Trump ne manquera certainement pas de réveiller le « vieux serpent de mer » à la veille de la prochaine assemblée générale de l’ONU en septembre prochain et sans doute bien avant…
Couper le financement de ces deux organismes, Président Trump a bien fait. Ces deux sont corrompus depuis les décennies.