
Une chronique de Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande
« Un homme qui a faim n’est pas un homme libre. » — Adlai Stevenson II (Ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies de 1961 à 1965)
Primordialité du droit à l’alimentation. Par Ioan Voicu
Remarques préliminaires
Le 24 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a estimé, dans une résolution de consensus, que « la faim constitue un outrage et une violation de la dignité humaine et nécessite donc l’adoption de mesures urgentes aux niveaux national, régional et international pour son élimination ». La faim, où qu’elle se trouve, constitue une menace réelle pour la stabilité mondiale, et le monde entier a la responsabilité morale de soutenir un accès équitable à l’alimentation. Relever les défis agricoles est une étape essentielle dans la bonne direction, mais parvenir à une véritable sécurité alimentaire mondiale nécessite une approche globale et inclusive qui garantisse le droit de chaque individu à une alimentation adéquate. Après tout, l’accès à une alimentation de qualité est un droit humain fondamental, pas un privilège.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a publié ses Perspectives mondiales 2025, qui évaluent les besoins mondiaux en matière de sécurité alimentaire et appelle à mobiliser quelque 16,9 milliards de dollars pour faire face à l’escalade de la crise mondiale de la faim – soit à peu près ce que le monde dépense en café en seulement deux semaines. Selon le PAM, la faim continue d’augmenter, avec 343 millions de personnes dans 74 pays souffrant d’insécurité alimentaire aiguë – une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière.
Ce chiffre comprend 1,9 million de personnes au bord de la famine, avec une faim catastrophique enregistrée dans des régions comme Gaza, le Soudan, le Soudan du Sud, Haïti et le Mali.
Il est signalé qu’en Asie de l’Est et dans le Pacifique, la hausse des prix des produits alimentaires essentiels exerce une pression considérable sur les budgets des ménages, en particulier pour les familles à faible revenu.
Cela a limité l’accès à la nourriture et son accessibilité, de nombreux ménages ayant du mal à répondre à leurs besoins fondamentaux. En République démocratique populaire lao, malgré une baisse de l’inflation à 16,9 % en glissement annuel en décembre 2024, les prix des biens restent élevés. En Indonésie, le bureau des statistiques a enregistré des fluctuations des prix des produits alimentaires stratégiques à l’approche des vacances de décembre 2024.
En Birmanie, le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’économie a conclu que la détérioration des conditions économiques au cours du second semestre de 2024, en raison des inondations, du conflit armé en cours et de la volatilité macroéconomique, a entraîné de graves pénuries et une hausse des prix.
Vers des solutions réalisables ?
La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) mentionnée ci-dessus est l’instrument collectif global le plus récent produit par la diplomatie multilatérale et elle sera succinctement analysée dans cette chronique. Elle est officiellement intitulée Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition et a été co-parrainée par la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et l’Ouganda (au nom des États membres du Groupe des 77 et de la Chine, y compris tous les pays de l’ASEAN).
Le texte comporte un immense préambule et 62 paragraphes opérationnels. Pour des raisons d’espace, cette chronique se concentrera uniquement sur les aspects essentiels en supposant que les revues universitaires produiront une analyse détaillée d’une problématique qui n’est malheureusement pas un sujet populaire pour les médias grand public.
Dans le préambule du document, après avoir rappelé toutes les résolutions pertinentes sur la question, l’AGNU s’est déclarée préoccupée par le fait que les causes multiples et complexes des crises alimentaires qui se produisent dans différentes régions du monde, affectant les pays en développement, en particulier les importateurs nets de produits alimentaires, et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et la nutrition nécessitent une réponse globale et coordonnée à court, moyen et long terme de la part des gouvernements nationaux, de la société civile, du monde universitaire, du secteur privé et de la communauté internationale.
L’AGNU a également réitéré l’idée que les causes profondes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition sont la pauvreté, les inégalités croissantes, l’iniquité et le manque d’accès aux ressources et aux possibilités de revenus, la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les effets du changement climatique, la perte de biodiversité et les catastrophes, les conflits et les tensions géopolitiques.
Le forum mondial reste préoccupé par le fait que la volatilité excessive des prix des denrées alimentaires peut constituer un sérieux défi à la lutte contre la pauvreté et la faim et aux efforts des pays en développement pour atteindre la sécurité alimentaire.
En outre, l’AGNU a réaffirmé le droit de chacun à avoir accès à une alimentation saine, suffisante et nutritive, conformément au droit à une alimentation adéquate et au droit fondamental de chacun à être à l’abri de la faim, afin de pouvoir développer pleinement et maintenir ses capacités physiques et mentales, et a souligné la nécessité de faire des efforts particuliers pour répondre aux besoins nutritionnels, en particulier des femmes, des enfants, des personnes âgées, des peuples autochtones, des communautés locales, des personnes handicapées, ainsi que des personnes vivant dans des situations vulnérables.
Dans le même contexte, il a été noté que le changement climatique a un impact disproportionné sur les personnes en situation vulnérable, en particulier les femmes et les enfants, et sur leurs moyens de subsistance, mettant en danger des centaines de millions de personnes, et il a été estimé que d’ici 2050, le risque de faim et de malnutrition infantile pourrait augmenter jusqu’à 20 % en raison du changement climatique.
La partie opérationnelle détaillée de la résolution commence par l’exhortation de l’AGNU aux États membres et à toutes les parties prenantes concernées à faire progresser les actions collectives pour faire face aux impacts multiples et généralisés de la pandémie de COVID-19, des conflits, du changement climatique, des catastrophes, de la dégradation des sols et de la perte de biodiversité sur le développement agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, afin de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
L’AGNU souligne également l’importance de la coopération internationale, du multilatéralisme et de la solidarité, notamment pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, à la protection sociale, au transfert de technologie selon des conditions mutuellement convenues, au renforcement des capacités et au soutien financier au développement agricole durable dans les pays en développement en tant qu’outil important pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous.
Au niveau organisationnel, l’AGNU a réaffirmé le rôle important et le caractère inclusif du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en tant que plateforme intergouvernementale majeure permettant à un large éventail de parties prenantes de travailler ensemble pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, et a encouragé les pays à promouvoir l’utilisation et l’application des directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, adoptées par le Comité en 2021, garantissant des systèmes alimentaires durables qui contribuent à la promotion d’une alimentation saine et d’une meilleure nutrition.
L’AGNU a également réaffirmé l’engagement qui est au cœur même de l’Agenda 2030 de ne laisser personne de côté, et s’est engagée à prendre des mesures plus concrètes pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et les pays les plus vulnérables et pour atteindre en premier lieu les plus défavorisés.
Enfin, le Secrétaire général des Nations Unies est prié de soumettre à l’AGNU à sa quatre-vingtième session, en 2025, un rapport orienté vers l’action sur la mise en œuvre de la résolution analysée ci-dessus et il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa quatre-vingtième session le point intitulé « Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition ».
Conclusions
Le droit à l’alimentation est un droit humain fondamental qui requiert une attention urgente et soutenue aux niveaux national, régional et international. La résolution de l’AGNU, qui a analysé la question, souligne la nécessité de mener des actions coordonnées, globales et inclusives pour faire face à la crise mondiale persistante et qui s’aggrave. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que personne ne soit laissé pour compte.
La résolution souligne que la faim n’est pas seulement le résultat de la pénurie alimentaire, mais qu’elle est profondément liée aux inégalités structurelles, au changement climatique, à l’instabilité économique et aux tensions géopolitiques. Par conséquent, les solutions doivent aller au-delà des avancées agricoles et englober la protection sociale, la réduction de la pauvreté et des systèmes alimentaires résilients qui donnent la priorité aux besoins des populations les plus vulnérables.
La coopération internationale et la solidarité multilatérale restent des piliers essentiels dans cette entreprise. La réaffirmation de l’importance d’organisations telles que le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et l’adoption de directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition indiquent une voie vers une sécurité alimentaire durable pour tous. Cependant, ces engagements doivent se traduire par des actions concrètes, avec des ressources financières adéquates, un renforcement des capacités et un transfert de technologie pour assurer un changement significatif et durable.
La demande d’un rapport pragmatique du Secrétaire général de l’ONU à la quatre-vingtième session de l’AGNU en 2025 offre l’occasion d’évaluer la mise en œuvre de ces engagements et de renforcer les efforts mondiaux. Les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les institutions internationales doivent travailler ensemble pour honorer leurs engagements et transformer les déclarations politiques en solutions concrètes et efficaces.
En fin de compte, l’éradication de la faim n’est pas seulement un impératif moral, mais aussi une condition préalable à la stabilité mondiale et à la dignité humaine. En adoptant une approche holistique et fondée sur les droits de la personne en matière de sécurité alimentaire, la communauté internationale peut se rapprocher de la réalisation de la promesse d’un monde libéré de la faim.
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.






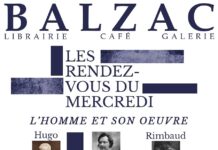
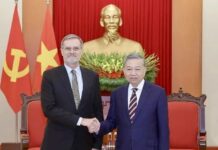





La chronique de Mr Voicu comme tant d’autres, illustre, s’il en était besoin, la crise des institutions internationales notamment onusiennes. Les alertes que celles-ci délivrent et notamment leurs organes spécialisés sont légions et depuis longtemps. Les propos développés et les données auxquelles ils se réfèrent sont d’autant plus catastrophiques que l’argumentaire évolue. Mais d’abord le constat est-il aussi alarmant ? Il faut d’abord s’entendre sur la notion de faim, d’ailleurs définie, différente de celle d’insécurité alimentaire. Il est à noter que les menaces concernent, sur d’autres registres, la mauvaise alimentation et l’obésité galopante, aussi bien dans les « pays riches » que les « pauvres ». Le périmètre des dégâts et des risques n’est pas le même, et il est peut être permis de penser que, relativement à l’augmentation démographique mondiale, l’ampleur de la situation semble avoir été contenue. Des analyses chiffrées existent mais elles sont contradictoires selon les bases retenues. Ce qu’il faut noter c’est que dans les causes retenues, la démographie n’est presque jamais évoquée. Elle semble être un tabou, du point de vue des États ou la transition démographique n’est pas faite et est alors considérée une atteinte à la « dignité » des populations. Il en est de même des conséquences migratoires qui sont également passées sous silence, et pourtant graves sources potentielles d’instabilité sécuritaire et économique. Les tendances démographiques mondiales lourdes semblent toutefois faire apparaître un ralentissement démographique plus ou moins sévère pour la fin du siècle.
D’ici là; les questions d’accès à l’alimentation restent pendantes et parmi les causes multiples invoquées, celles relatives à l’environnement et au réchauffement climatique sont mises en avant. Le motif est certes un plus grand mobilisateur des préoccupations mondiales et plus incitatif au niveau des contributions notamment financières requises.
Mais beaucoup d’aspect liés au modèles économiques en vigueur dans le secteur agricole ne sont pas abordés ni leurs effets. L’un d’eux est la spécialisation industrielle des secteurs de productions à l’échelle de la planète et la destruction de secteurs nationaux entiers de l’agriculture (résistance de agriculteurs au mercosur). Ces secteurs fortement capitalistiques, dominés par la recherche de la rente financière, sont à même de modifier les marchés et les prix pour des raisons essentiellement spéculatives. D’où la hausse des produits de l’alimentation dans la plupart des pays et les risques encourus pour leur stabilité politique. Si les guerres comme causes des phénomènes observés sont parmi les causes premières, l’alimentation est aussi une arme géopolitique comme on l’a constaté depuis l’annexion de l’Ukraine par la Russie et son impact sur l’acheminement et le cours des céréales. Un autre exemple a été fourni par la rétention et le contrôle de l’aide alimentaire et médicale apportée à la population de Gaza et son contrôle par le Hamas qui la revendait en multipliant les prix tout en dénonçant le crime de génocide par Israël. L’exemple de l’Holodomor ukrainien et la famine organisée par Staline est un autre exemple. Cette situation semble assez répandue à l’échelle planétaire ou l’on assiste à la captation des aides par des dirigeants corrompus et à leurs profits personnels.
Mais ce que je retiens de la chronique c’est l’illustration du caractère incantatoire et verbal si ce n’est verbeux du droit international n’embrayant que peu sur les réalités et dont la description et l’analyse est loin d’être complète. De là à inventer une nouvelle « lubie » à allure juridique, un « droit pas comme les autres », un « nouveau droit » ? Quel contenu lui donner, un caractère d’opposabilité absolue (sur le mode du droit au logement opposable en droit français), impliquant une responsabilité étatique effective, un contrôle de celle-ci, le prononcé d’indemnisations, des recours individuels à l’instar de la cour européenne des droits de l’Homme ?
Cette chronique comme beaucoup d’autres relatives aux institutions internationales notamment onusiennes rappelle la fameuse phrase attribuée à Bossuet : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». La lecture de l’ouvrage de Jean Ziegler, « La faim dans le monde expliquée à mon fils », publié en 2015 aux Ed. du seuil (63 pages) n’a pas pris une ride, malheureusement…