
Une chronique siamoise et sociétale de Patrick Chesneau
Comme un joyau brut et raffiné. Krungthep Maha Nakorn, de son nom thaï, témoigne d’une épopée tour à tour pudique, alanguie, débridée et frénétique. Ville-capharnaüm où la raison est prompte à s’égarer. Tout est tohu bohu. La mégapole vibre au gré des migrations pendulaires de ses quinze millions d’habitants. En toile de fond, elle est une bande son stridente, syncopée, obsessionnelle. En ces lieux tentaculaires, le lobe frontal se transforme en chambre d’écho.
Décibels de jour, décibels de nuit. Une nouvelle syntaxe audio, ponctuée de sensations expérimentales, s’écrit dans l’urgence. Pour survivre, il y a nécessité d’entrer en osmose. Tout repose alors sur l’éventualité d’une connivence avec les sortilèges d’Orient. Une alchimie céleste percutée par les vicissitudes souvent brutales des jours ordinaires. Pour le visiteur, commence invariablement une expérience initiatique. Plus qu’une fulgurance circonstancielle, un leitmotiv perpétuel.
Égrener les atouts de la » Grosse Mangue » prend l’allure d’un défilé haletant. Il y a d’abord l’énumération de quartiers tout en contrastes, délimités ça et là par le fleuve Chao Phraya.
Il convient d’ajouter la profusion des artères constamment sur le pied de guerre, la thrombose automobile, les rues assiégées par les foules bigarrées, les soï (prononcer so-i, ruelles ) trépidantes livrées aux carrioles brinquebalantes des petits métiers si besogneux. Les marchés, les centres commerciaux, les temples. Comment ne pas perdre pied dans cette succession de climats urbains? Vertiges et tournis s’empilent au diapason de pensées enchevêtrées.
Trop plein inextricable.
Et pourtant, au cœur du maelstrom tropical, le miracle s’accomplit. Du fatras naît l’épure. Du fouillis surgit la poésie. Dans l’impromptu des mots, une émotion originelle, instinctive, atavique se fraie un chemin. L’instant tient du miracle. Guidant vers l’accomplissement des sens. Un précipité d’images concassées laisse entrevoir une éblouissante mosaïque. Résonne le doux babil de quelques mythiques rivières de perles, habillées en blanc ivoire, dans une topographie tourmentée parcourue de reflets pourpres. C’est à ce moment que jaillissent les prolégomènes de l’harmonie.
Miraculeuse hybridité de la ville fusion. Même en plein charivari, flamboie une pulsion de vie.
Patrick Chesneau
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.




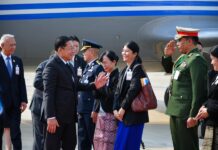

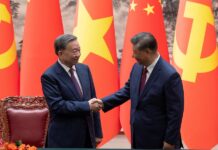






L’accumulation des brics à bracs obsessionnels ornés d’une vaine prose boursouflée, et asphyxiée dont le sourire Thaï est le déclencheur va t-elle bientôt accoucher ? Mais de quoi ?
Dans ses promenades en Italie, Stendhal (« Rome, Naples et Florence, 1826) décrit les effets inexplicables par la visite, en 1817, de Santa Croce de Florence. Le visiteur lointain, menacé par le vide d’être et propulsé dans l’aventure du « voyage », se sent submergé par des sensations jusqu’alors inconnues, une sorte de « possession ». Des symptômes tellement intenses qui le conduisent aux consultations psychiatriques locales. Le diagnostic n’était pas aisé et était livré à toutes les conjectures. Les symptômes, eux, étaient assez répertoriés. une sorte de coma léger suivait des sensations d’oppression, de halètements, de vertiges, de suffocations voire d’hallucinations puis de délire verbal, une sorte de tsunami d’ épithètes qui, comme un rideau dissimule le réel. La réalité contre la réalité. Le réel de l’être opposé à la réalité supposée perçue et fantasmée. Le roman de Thomas Mann « La mort a Venise » expose une forme du même symptôme submergeant le vieux professeur Gustav von Aschenbach face à la beauté solaire de Tadzio, une beauté qui tue… celle d’un adolescent substitué au « david » statufié, touchant la libido du professeur jusqu’à la syncope.
A la lecture des chroniques qui se succèdent, le sourire thaï supposé énigmatique et dissimulateur, mais de quoi, prend la place du David de la place de offices ou de quelques déesses vénusiennes, dénudées, ou de quelque Narcisse caravagesque suspendus aux murs de la galerie des offices. Le « sourire thai » se révèle être le détonateur qui déclenche la furie verbale qui allume le feu des mots et surtout des adjectifs et des épithètes au risque de provoquer l' »obscurcissement de l’esprit », les « pensées enchevêtrées » et, comme un château de cartes, un effondrement, une liquéfaction de l’être Cet incendie ravage tout ce qui se trouve sur son passage. Il ne reste plus que les cendres surgissant de cette crémation verbale jaillissant de l’urne,… les « prolégomènes à l’harmonie »… de l’être accueilli par le néant.
Bangkok ne serait qu’un des lieux de cette possession sur lequel notre chroniqueur soulève le voile. La précipitation des masses visiteuse devant la Joconde semble être une même manifestation du même symptôme. Le « lancer de soupe » dont elle fût victime ne fût qu’un moment exacerbé de la furie du symptôme. Son sourire énigmatique qui, comme le fameux sourire thaï, semble regarder en arrière, jette le spectateur dans un état second. Il sent profondément que Mona Lisa perce le fonds de son être et le met nu », met son vide d’être à nu … Un « sentiment océanique » submerge tout l' »univers » de ce spectateur agonisant. Une possession mais une dépossession en même temps. Sylvain Tesson au fil des reportages-romans réédite une forme de syndrome de Stendhal sur les bords du lac Baïkal et du fonds des forêts de Sibérie avec – 20 degrés. Ici la chaleur italienne, là le froid russe, deux ingrédients extrêmes du phénomène. Camille Brunel, dans son « éloge de la baleine » (éd. Payot et Rivages2022, 208 pages) a conçu ce type de syndrome en observant des baleines à bosses au large du Mexique. L’observation obsessionnelle et dans les yeux des cétacés, l’échange érotique que la contemplation produit, le convainquent que rien, ni d’humain n’existe face à la nature. Rien que la baleine… alpha et oméga du monde… Une expérience de l’être vide mais prenant la forme d’un narcissisme retourné, exacerbé. Du regard du cétacé au sourire thaï n’y aurait-il qu’un pas ? D’autres exemples et d’autres lieux semblent générer de telles expériences extatiques et, parmi elles, au sommet, Jérusalem. La composante religieuse et mystique semble fournir un carburant plus ou moins explicite mais toujours présent du phénomène. D’après le psychiatre japonais Hiroaki Ota, les nippons seraient les victimes de choix de la « stendahlité » mais à Paris. Dans une étude publiée en 2004, 63 japonais ( 29 hommes et 34 femmes) auraient séjourné à l’hôpital Sainte-Anne entre 1988 et 2004 victimes du « syndrome de Paris ». La distance cultuelle serait le moteur des symptômes mais surtout la déception face à une ville idéalisée et mythifiée qui, dans la réel (opposé à la réalité, subjective et ici idéalisée), expose sa « saleté » et tous les travers des attitudes et des comportements des Français à l’opposé des mœurs japonaises. Le psychiatre Régis Airault a pu observer de nombreux cas semblables pendant qu’il était en poste au consulat de Bombay qu’il décrivit dans un livre « Fous de l’Inde », publié en 2000. Jusque là Bangkok n’était pas répertorié dans la liste des lieux ou le phénomène sévit, à l’exception des tourments d’un moine bouddhiste qui, dans le roman de Y. Mishima, « Le pavillon d’or » (1956) met le feu au pavillon alors qu’il est obsédé par la beauté du lieu. Il revient à Gavroche et à un de ses chroniqueurs d’avoir permis d’enrichir l’approche d’un phénomène mystérieux que vos lecteurs ne se lassent pas d’essayer de comprendre…
Un grand merci cher lecteur pour votre commentaire sur les chroniques de notre ami Patrick Chesneau. Le principe des chroniques comme vous le savez est d’adopter un ton personnel. Nous le respectons, mais nous écoutons toujours avec attention nos lecteurs ! Continuez de nous lire !