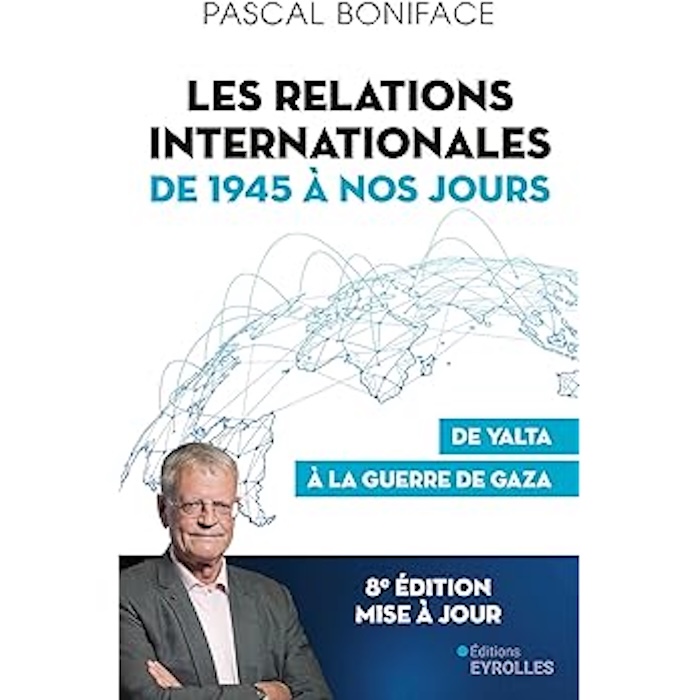
Une chronique de Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande
Dans cette chronique destinée aux lecteurs de Gavroche, nous allons analyser l’ouvrage signé de Pascal Boniface intitulé : « Les relations internationales de 1945 à nos jours : De Yalta à la guerre de Gaza », publié par l’Éditeur EYROLLES en 8e édition, à Paris, en juin 2024, dans un volume de 262 pages.
Dans cet ouvrage, Pascal Boniface propose une analyse limpide et captivante de près de huit décennies de transformations géopolitiques. De la Guerre froide aux conflits contemporains, en passant par les grandes mutations de l’ordre mondial. Cet ouvrage éclaire les continuités et les ruptures qui façonnent notre présent.
Écrivant avec clarté et précision, l’auteur,une grande plume diplomatique, offre aux lecteurs les clés pour comprendre les dynamiques internationales et envisager le futur avec discernement. C’est une lecture incontournable pour qui souhaite appréhender les enjeux de la mondialisation et les rapports de force du XXIe siècle.
Pascal Boniface est directeur-fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et fondateur de l’école IRIS Sup’. Connu pour ses qualités pédagogiques, il anime la chaîne YouTube « Comprendre le monde ». Il est déjà l’auteur de plus de 70 ouvrages sur les relations internationales et la géopolitique.
En raison du manque d’espace, nous ne pouvons pas proposer une chronique détaillée de ce grand ouvrage, mais nous essaierons de résumer, en utilisant la terminologie exacte du livre, les principales découvertes et conclusions sur l’Asie.
Cependant, afin d’offrir aux lecteurs une image générale de l’ensemble du contenu du livre, il est nécessaire de préciser que cet ouvrage est composé de deux parties : première partie – un monde bipolaire, deuxième partie – vers un monde multiple, couvrant un total de 7 chapitres avec des titres symboliques comme suit : La fin de la Seconde Guerre mondiale ; La guerre froide ; La coexistence pacifique ; La détente ; Fin de la détente et nouvelle guerre froide ; La fin du monde bipolaire ; Un monde en recomposition.
Ce dernier chapitre, le numéro 7, comporte plusieurs sections intéressantes telles que : États-Unis, l’illusion perdue d’un monde unipolaire ; Une puissance agressive ; L’espoir Obama ; Donald Trump : l’unilatéralisme débridé ; Joe Biden, le retour de l’Amérique ? ; La Russie, un retour en force remis en cause par la guerre ; Sur fond de guerres de Tchétchénie ; L’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir ; L’Europe en difficulté ; La redéfinition de la sécurité européenne ; L’élargissement de l’Europe ; Le Proche-Orient, toujours dans la tourmente ; L’Asie, nouveau centre du monde ? ; Une autre Amérique latine ; L’Afrique dans la mondialisation.
Pascal Boniface signe également dans son ouvrage une introduction inspirante et quelques conclusions qui font réfléchir.
Rappel des événements asiatiques et des acteurs majeurs
La première référence à l’Asie comme continent apparaît dans l’ouvrage dans le contexte historique suivant : « La Seconde Guerre mondiale est partie d’Europe. Elle s’achève en Asie en août 1945 ». (p.7) Les États-Unis sont les seuls à être plus riches à la fin de la guerre qu’au début. « Présents militairement en Europe et en Asie, ils vont utiliser leurs forces pour prendre la tête du monde libre et en finir avec l’isolationnisme. »(p.18)
En Asie du Sud-Est, le Japon, qui avait envahi les colonies françaises et néerlandaises, s’était présenté comme un libérateur, l’invocation de la solidarité des peuples asiatiques permettant de masquer son propre colonialisme.(p.21)
De l’avis de l’auteur, on peut situer la première vague de décolonisation entre 1945 et 1953 et il commence le récit pertinent par l’Asie : Dès 1945, le gouvernement travailliste britannique est décidé d’abandonner sa souveraineté sur le sous-continent indien et souhaite accorder l’indépendance à un État indien unifié. Le Bill of Independance du 15 juillet 1947 constitue deux États distincts : l’Union indienne, regroupant les hindouistes ; et le Pakistan regroupant les musulmans et se constituant de deux provinces séparées par l’Inde. Six cents États-princiers (Raj) regroupant 80 millions d’habitants se lient à l’Inde.Mais les lignes de démarcation entre les deux nouveaux États ne correspondant pas de façon exacte aux répartitions religieuses. Il s’ensuit une guerre civile intercommunautaire, des destructions matérielles considérables et des transferts massifs de population : 16 millions de personnes déplacées dont 10 % ne parviendront jamais à un nouveau lieu de résidence. Les deux nouveaux États se livrent une guerre immédiat pour le contrôle du Cachemire.
Les autres colonies britanniques suivent l’exemple indien : la Birmanie et Ceylan (actuel Sri Lanka) deviennent indépendantes en 1947, la Malaisie en 1957 – dont Singapour se détaché en 1958 pour devenir un État. Accord de Washington en 1946, une indépendance contrôlée aux Philippines.
Dans une sous-section de l’ouvrage intitulée Crises et guerres en Asie, Pascal Boniface considère que Les États-Unis et l’URSS subissent deux échecs en Asie, les premiers avec la guerre du Vietnam, les secondes avec la Chine. (p.82)
Dans des paragraphes distincts, les lecteurs apprennent que sous le titre « Le réveil de l’Asie » il faut comprendre qu’en effet L’Asie se met à compter sur l’échiquier mondial. Le premier exemple cité est L’émergence du Japon. La guerre de Corée et la présence massive de soldats américains en Asie ont permis le re-décollage économique du Japon. L’ex-ennemi des États-Unis est devenu la base avancée de Washington dans la lutte contre le communisme en Asie-Pacifique. Cependant, de manière réaliste, l’auteur de l’ouvrage considéré conclut encore : « En Asie, le monde communiste apparaît en expansion ». (p.118)
En traitant des questions militaires sur le continent asiatique, l’auteur affirme qu’« En Asie, le déploiement des SS-20 a eu pour effet d’augmenter les dépenses militaires japonaises et de mettre en place une plus grande coordination stratégique entre le Japon et les Occidentaux, les États-Unis notamment. » (p.126)
Dans le dernier chapitre de l’ouvrage intitulé Un monde en recomposition, l’auteur estime que La fin du monde bipolaire crée une véritable révolution stratégique… « en Asie et en Amérique latine, des pays émergent. Le monde se recompose. » (p.169)
En référence expresse uniquement à l’Asie, l’auteur ajoute des constats pertinents : « La Chine est perçue comme un défi majeur. Pour y répondre, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire et économique dans la zone Asie-Pacifique. Ils ont signé un accord de partenariat transpacifique en 2016, renforcé leur coopération militaire avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et développé une relation avec le Vietnam. » (p.174)
Dans une sous-rubrique intitulée Crises en Asie, Pascal Boniface informe les lecteurs que l’Asie est un continent traversé par des tensions. La fin de la guerre froide n’y a pas eu la même signification qu’en Europe. Les contentieux bilatéraux sont nombreux et la différence de taille des acteurs empêche un équilibre réel des forces. « C’est la présence militaire américaine qui permet de stabilisateur la région ». (p.233)
Par ailleurs, l’auteur n’ignore pas la dimension économique des événements asiatiques. Il rappelle que « L’Asie a été frappée en 1997 par une grave crise financière, rejetant dans la misère une partie de la classe moyenne. En juillet 1997, le cours du baht thaïlandais s’effondrait, entraînant dans sa chute les monnaies malaise et indienne. » (p.239)
De l’une des dernières références expresses à l’Asie en tant que continent trouvée dans le livre en question, les lecteurs apprendront que « L’Asie apparaît comme le continent gagnant de la mondialisation et devient le centre de gravité économique et démographique du monde. Mais elle reste éclatée stratégiquement, traversée par de nombreuses divisions et rivalités ». (p.240)
Les lecteurs de ce livre trouveront 127 références spécifiques sur la Chine. Pour des raisons d’espace, nous ne pouvons en reproduire qu’un qui semble très pertinent en 2025 : « La montée en puissance de la Chine inquiète les États-Unis, peu disposés à lui céder la suprématie mondiale. La compétition entre Pékin et Washington diffère de celle entre l’URSS et les États-Unis. Pékin n’est pas à la tête d’un système d’alliance militaire, mais gagne du terrain sur le plan diplomatique et économique. Elle est devenue premier partenaire commercial de plus de cent pays à travers le monde.[…] La Chine veut avant tout effacer les humiliations du xix -e siècle et du début du xx- e siècle et reprendre la première place d’un monde cette fois-ci globalisé ». (pp.231-232)
Conclusion
Nous préférons laisser la parole à Pascal Boniface pour finaliser cette chronique, car certaines de ses constatations formulées dans un ouvrage paru à Paris en juin 2024 s’avèrent tout à fait pertinentes en avril 2025 dans une perspective asiatique. Les voici : « Aucun pays du Sud global, y compris ceux qui ont condamné l’agression de l’Ukraine, n’a pris de sanctions contre la Russie.[….] Le résultat du duel Chine/États-Unis dépend très fortement des relations que Pékin et Washington auront vis-à-vis du Sud global. Pékin est en train de prendre un avantage sur ce terrain. Pour le moment. Reste à suivre les évolutions futures. L’histoire, comme toujours, est en marche ». (p.257)
Ce livre brièvement présenté ci-dessus est capable d’aider les lecteurs de tous âges à décrypter l’actualité et de percevoir le monde dans sa globalité. Il est vrai que la période contemporaine ne cesse de nous surprendre et donc cet ouvrage peut être un indispensable instrument académique pour les lecteurs désireux de prendre du recul pour aborder la mondialisation de façon éclairée et le présent en connaissance de cause.
Il est indéniable que L’Histoire a imprimé des souvenirs profonds dans la mémoire des peuples et des nations. Ignorer ces héritages, c’est se priver de la clé de compréhension des choix d’aujourd’hui, du sens et de la logique des événements internationaux qui façonnent notre présent.
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.












