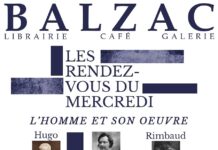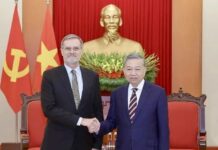Une chronique birmane de François Guilbert
Depuis son élection en novembre 2024 et plus encore depuis sa prise de fonction le 21 janvier, Donald Trump veut montrer à la face du monde qu’il cheffe et sait cheffer. Après avoir décidé la suspension immédiate des aides au développement pour examiner l’efficacité des concours américains et mesurer leur concordance avec les priorités énoncées par la Maison Blanche, les premiers effets se font sentir sur les populations birmanes. Ils sont d’ores et déjà tangibles sur des populations vulnérables vivant en Birmanie mais aussi sur des personnes réfugiées dans les pays voisins, à commencer par le Bangladesh, la Malaisie et la Thaïlande.
Les centaines de réfugiés birmans devant rejoindre prochainement les États-Unis sont maintenus dans leur pays de premier accueil
Les programmes de réinstallation de réfugiés sont stoppés. Dans les camps où les candidats au départ se préparaient à émigrer, il leur a été notifié un report de plusieurs mois. En février et en mars, il n’y aura personne en partance. Après les 90 jours de revoyure de tous les programmes des agences états-uniennes, les bénéficiaires déjà identifiés ne sont pas certain de voir aboutir leur projet de migration vers l’Amérique du nord. A vrai dire personne n’est à même de les renseigner. Leur anxiété est maximum. Ceux qui leurs viennent en aide sont tout autant désemparés. Ils constatent avec consternation les dégâts émotionnels sur leurs interlocuteurs ; leur projet de vie venant tout simplement de s’effacer pour de nombreuses années. Voilà une épreuve de plus pour des familles qui n’en ont pas manqué dans le passé récent.
Washington ne se préoccupe pas des conséquences immédiates de ses actes
L’administration se devant de mettre en œuvre sans délai la décision présidentielle et édictée par le Département d’État le 29 janvier, sous peine de sanctions pour ses agents, elle constate les dégâts sans pour pouvoir y remédier en rien. Il ne faut pas se cacher la face, la mesure de suspension des aides américaines va avoir un effet létal à très court terme.
En Birmanie même, près de 100 000 personnes infectées par le VIH et la tuberculose risquent de se voir privées de soins à brève échéance. La fin des programmes anti-SIDA par D. Trump (PEPFAR) va s’avérer une catastrophe humanitaire. Les acteurs de mise en œuvre n’ont pas le temps de se retourner. Il n’y a pas de solutions alternatives immédiates. A supposer que de nouveaux bailleurs de fonds internationaux se signalent rapidement, l’abondement des budgets prendra des mois. En attendant, il faut réduire la voilure des actions. Les distributions de médicament se ralentissent voire cessent déjà. Des licenciements dans les organisations non gouvernementales et de la société civile vont rapidement intervenir. La décision washingtonienne a un effet systémique.
Aux frontières thaïlandaises, on en ressent aussi les effets. Ils sont à la fois matériels et psychologiques. Personne ne sait de quoi sera fait la solidarité américaine de demain. Ainsi, l’International Rescue Committee (IRC) qui intervient dans les neuf camps de réfugiés en Thaïlande suspend à partir de cette semaine ses concours aux services de santé. Cela concerne notamment les soins ambulatoires et hospitaliers, la santé reproductive et infantile. Pour les acteurs humanitaires sur le terrain, cela veut dire très concrètement rechercher en urgence des solutions pour les patients en situation critique.
Face aux drames qui se profilent, les autorités du Royaume multiplient les réunions de travail pour trouver des solutions immédiates les moins pénalisantes. Mais elles savent que c’est toute la chaîne de santé et d’aide au développement (ex. accès à l’eau, agriculture, éducation,…) qui est mise à mal et probablement pour longtemps. Les États-Unis sont des acteurs majeurs de la scène humanitaire le long de la frontière birmane. Bangkok ne peut constater qu’avec dépit que son grand allié ne se soucie guère des problèmes qu’il lui crée. Les autorités thaïlandaises sont prises autant au dépourvu que les agences onusiennes et les organisations non gouvernementales bénéficiant jusqu’ici de soutiens financiers des États-Unis, et en premier lieu de l’USAID. Aucune étude d’impact n’a d’ailleurs été réalisée avant l’instruction de suspension des aides. La mouvance trumpienne n’en a cure.
Le 47ème président des États-Unis n’hésite pas à brocarder les aides apportées aux Birmans.
Évoquant devant la presse, le programme de bourses d’études « Diversité, inclusion, équité et accessibilité », il s’est étonné que 45 millions de dollars aient été mobilisés, jugeant sous les sarcasmes de ses auditeurs cet apport excessif. Il ne fait aucun doute que la revoyure des aides existantes va se traduire par des suspensions définitives de nombreux projets. L’influence des États-Unis en pâtira sans aucun doute.
Les électeurs américains ne s’en inquiéteront certainement pas à ce stade mais au Congrès des élus démocrates et républicains vont chercher à mitiger l’ardeur du maître de la Maison Blanche car ils savent ô combien l’aide au développement, l’éducation et la santé sont des instruments de politique étrangère, des leviers d’influence et du soft power. A fortiori auprès d’une population chaque jour un peu plus dans le besoin (49,7 % de la population vivant sous le seuil national de pauvreté, 19,9 millions de personnes en besoins d’aides humanitaires) et dont 40 % des jeunes aspirent à quitter au plus vite le pays.
Devant ces perspectives bien sombre, une seule nouvelle un peu plus rassurante. Les populations rohingyas ayant trouvé refuge au Bangladesh semblent parmi les moins touchées parmi les coupures budgétaires. Washington n’a pour l’heure pas remis en cause ses soutiens aux fournitures d’aide alimentaire. Une chance car les programmes des Nations unies sont déjà très largement sous-financés par rapport aux besoins croissants. Dacca s’en est d’ailleurs félicité publiquement auprès du Département d’État le 26 janvier.
Mais pour avoir une vue d’ensemble du réordonnancement de l’action extérieure états-unienne en matière d’aide au développement, il nous faudra attendre au minimum jusqu’à la mi-avril. D’ici-là, espérons que le Secrétaire d’État Marco Rubio sera faire preuve de flexibilité en accordant quelques dérogations programmatiques. Lui seul a le pouvoir d’accorder des exemptions aux coupures qui viennent d’intervenir. Espérons qu’il saura se montrer ouvert, par exemple, à ne pas mettre à mal les soutiens apporter à la liberté de la presse birmane. Face à un régime militaire et à l’heure d’une guerre civile aussi meurtrière que cruelle, l’accès à une information de qualité est un enjeu majeur.
Formons le vœu que les États-Unis ne fassent pas le jeu d’une junte autocratique par idéologie, négligence démocratique et administrative.
Ce n’est pas en étant tenté de soutenir des organisations confessionnelles et en apportant des aides au secteur entrepreneurial privé que les États-Unis combattront le plus efficacement possible l’alliance des autocrates en Asie. L’opposition démocratique birmane l’a bien compris. La ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’opposition (NUG) a ainsi souhaité lors de sa dernière conférence de presse que le gouvernement des États-Unis « continuera à soutenir le peuple de Birmanie ».
Elle ne peut en dire beaucoup plus puisque son gouvernement ne bénéficie pas d’aides directes de l’administration américaine. Ses départements ministériels n’en doivent pas moins se montrer vigilants car dans les territoires, que lui et ses alliés ethniques administrent, les organisations de la société civile bénéficient, ici et là, de subsides venant de bailleurs co-financiers américains. Il n’y a pas dire : à l’heure du quatrième anniversaire du coup d’État militaire birman, D. Trump s’engage sur la voie d’une politique étrangère où les valeurs humanistes sont loin de constituer un pan important de son projet pour les quatre années qui viennent ! C’est pourtant en Birmanie que l’on observe la régression démocratique la plus profonde et la plus déstabilisatrice pour l’Asie.
François Guilbert
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.