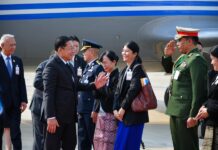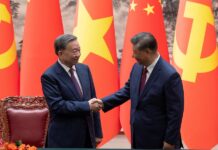Pendant les heures de pointe, seule l’armée de motos-taxis peut se faufiler dans les rues engorgées de Bangkok. A Bangkok, ce métier, autrefois entièrement dominé par les hommes, attire de plus en plus de femmes, motivées par la liberté et les revenus que procure cette activité.
Kamokwan Sangngian, 40 ans, attend les passagers qui débarquent de la station de BTS On Nut, à l’est de Bangkok. Sa mission ? Manoeuvrer son scooter dans les soïs étroits pour amener ses clients vers leur destination le plus vite possible, pour 30 à 50 bahts la course. « Une amie à moi travaillait pour cette file, la plus proche de chez moi. Je lui ai demandé de m’obtenir un entretien avec la cheffe du groupe. »
Il y a trois ans, fatiguée de son boulot à l’usine, Kamokwan quitte Nakhon Si Thammarat et vient tenter sa chance à Bangkok. Elle travaille maintenant six jours par semaine de 7h à 16h, des horaires qui lui permettent d’aller chercher son enfant à l’école. « J’aime la liberté que ce métier m’apporte. Je peux choisir mes heures de travail et passer du temps avec mon fils. Et je gagne bien ma vie. Je peux même lui payer des cours de taekwondo », dit-elle en montrant une photo d’un petit garçon en tenue de combat sur son smartphone.
Conduire une moto-taxi a longtemps été une activité exercée par les migrants des provinces. Des dizaines de milliers d’entre eux ont quitté Bangkok après les fermetures d’usines et les plans de licenciements massifs consécutifs à la crise financière asiatique de 1997 qui a durement touché la Thaïlande. Mais ils sont progressivement revenus exercer ce métier dans la capitale et l’écrasante majorité des chauffeurs de motos-taxis est toujours originaire des provinces hors de Bangkok. Pour sa thèse sur les chauffeurs de mototaxi et la politique (Harvard University, 2013), Claudio Sopranzetti, docteur en anthropologie, a passé des mois à interviewer ceux que les Thaïlandais appellent les « P’win ». Le mot « itsaraphap » revient régulièrement dans ces entretiens : une notion qui se situe entre la liberté et l’indépendance et qui compense aux yeux des chauffeurs le stress et les dangers liés à leur activité. Pour Claudio Sopranzetti, cette quête de l’itsaraphap est un « cadre primordial pour comprendre la vie en Thaïlande. »
Mais les femmes doivent se battre pour se faire une place dans ce milieu. « Quand j’ai commencé à conduire, certains hommes dans la file me lançaient constamment des piques. J’ai dû faire mes preuves pendant quelque temps pour faire cesser le harcèlement. Ils essayaient de me faire abandonner car ils avaient peur de la compétition », témoigne Kamokwan.
Kyoko Kusakabe, professeure à l’Institut Asiatique de Technologie (AIT) à Pathum Thani, consacre ses recherches à l’emploi des femmes dans l’économie informelle, à la migration professionnelle et à la mobilité entre les genres. Elle voit des parallèles avec d’autres secteurs dominés par les hommes en Thaïlande. « Au début, les hommes rendent la vie difficile à leurs collègues féminines car ils sont inquiets de perdre l’image de travailleurs acharnés que la société a d’eux si trop de femmes intègrent leur profession et font le job aussi bien qu’eux. »
Les conducteurs de motos-taxis ont des permis jaunes, différents de ceux qu’obtiennent les particuliers. Ils le reçoivent après un test pratique et théorique où ils doivent avant tout démontrer leurs connaissances des axes de Bangkok et leur capacité à se repérer.
Chaloem Changthongmadn, président de l’Association des Motos-Taxis de Thaïlande (AMTT), estime que 200 000 conducteurs travaillent dans la ville et opèrent d’environ 6100 files, appelées « win ». Aucune statistique basée sur le genre n’est disponible mais Chaloem présume qu’environ 10% des chauffeurs à Bangkok sont aujourd’hui des femmes, alors qu’elles étaient pratiquement absentes du secteur il y a encore quelques années.
La file d’On Nut compte sept femmes sur la centaine de chauffeurs. Somlit Lalert, 46 ans, en est la cheffe désignée. « Je suis venue de Trat il y a dix ans avec mon mari. Nous sommes entrés dans ce métier ensemble. J’étais la seule femme de la file à l’époque. Après quelques années, j’ai été élue par les chauffeurs à la tête de notre win. Maintenant, des femmes viennent presque tous les jours me demander du travail. Elles voient de plus en plus de femmes conductrices de moto-taxi dans les rues de Bangkok et se sentent plus en confiance pour faire la même chose. »
Somlit Lalert a pour rôle de vérifier que tout le monde vienne au travail, d’assister à des réunions avec des officiers de police et les autorités, d’informer les conducteurs de changement de législation et de sermonner ceux qui se sont mal comportés. Elle gère aussi le fonds d’assurance santé propre à chaque win. Tous les mois, chaque conducteur dépose 100 bahts dans une caisse. Si l’un d’entre eux tombe malade, il peut recevoir jusqu’à 2000 bahts pour compenser la perte de journées de travail. « C’est beaucoup de travail de gérer la file, mais je suis fière de représenter notre groupe », assure Somlit. Une visiblité grandissante et la solidarité féminine permettent à davantage de femmes d’entrer dans cette profession. Mais la professeure Kyoko Kusakabe voit des raisons structurelles à ce nouveau phénomène. « Il y a de moins en moins de postes non qualifiés. Les jobs faiblement payés dans la construction et sur les marchés sont occupés en grande partie par des migrants cambodgiens et birmans. Les Thaïlandais ne veulent plus des jobs, mais n’ont pas encore les compétences pour trouver de meilleurs emplois, donc ils se retrouvent avec moins d’opportunités. »
Et en temps de crise, les femmes sont davantage menacées que les hommes, poursuit Kyoko Kusakabe. « Ils s’inscrivent dans une école professionnelle pour apprendre un métier, comme électricien ou technicien. Ils retournent dans les provinces où le gouvernement leur fournit du travail. Mais il n’y a rien de prévu pour les femmes. Conduire un taxi ou une moto-taxi devient alors une alternative de plus en plus tentante, même si le secteur ne peut absorber toutes les femmes qui cherchent du travail. »
Luksika Yathong, conductrice de moto-taxi à Lad Phrao, est membre de l’Association des Motos-Taxis de Thaïlande, qui a été formellement établie en 2010.Les motosaï rap chang -ou motorcy rapjang- (littéralement «motos à louer ») opèrent entre 4 à 6 millions de trajets par jour, soit près de 10 fois le nombre de trajets quotidiens effectués sur le métro et le BTS combinés. (Source : Claudio Sopranzetti The Owners of the Map, Harvard University, 2013).
Dans un coin tranquille de Lad Phrao, Luksika Yathong, 36 ans, passe l’éponge sur le stand de nouilles qu’elle gère avec son mari depuis quinze ans. Elle est prête pour son deuxième job de la journée. Il y a quatre ans, le couple a commencé à conduire des motos-taxis à temps partiel pour s’assurer un revenu supplémentaire et être en mesure de financer l’éducation de leurs deux fils adolescents. Luksika préfère travailler hors des quartiers animés comme Sukhumvit, Silom et Khao San Road. « Il y a plus d’étrangers, donc il y a beaucoup d’argent en jeu. Ici, nous avons moins de clients, mais au moins nous n’avons plus à payer la mafia pour faire notre boulot. »
Quand Luksika et son mari ont commencé à conduire, ils payaient 4 000 bahts par mois chacun pour pouvoir travailler dans la file. Pendant des années, les chauffeurs ont accumulé de lourdes dettes pour payer des raquetteurs, officiers de police y compris, lors de l’achat initial de la précieuse veste orange ou sous forme de pots-de-vin mensuels. La veste faisait l’objet d’un trafic juteux et pouvait être revendue et achetée à l’infini, avec un montant de départ s’élevant jusqu’à 200 000 bahts, auquel s’ajoute des versements mensuels pendant les premières années. La valeur d’une veste dépendait de la popularité du quartier et de la file, des relations entre le vendeur et l’acheteur et de la situation du marché au moment du transfert. « La veste est désormais gratuite et fournie par le Département des Transports. Si quelqu’un doit toujours payer car il a été pris au piège dans l’ancien système, ce n’est pas normal et il devrait contacter notre association », prévient Chaloem Changthongmadn, de l’AMTT.
En 2003, l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a tenté d’intégrer les P’win dans l’économie officielle, un des axes de sa « guerre contre les influences néfastes ». Son gouvernement a introduit un système d’enregistrement régulé par l’Etat pour mettre fin aux pratiques qui étouffaient la profession et les vestes ont été délivrées gratuitement. Mais après le coup d’Etat qui a renversé le fondateur du parti Thaï Rak Thaï en septembre 2006, le contrôle est retombé dans les mains de diverses mafias.
En mai 2014, le général Prayuth Chan-ocha a saisi le pouvoir en citant la corruption comme une des principales raisons du coup d’Etat. Depuis, la junte militaire a annoncé une fois encore vouloir réformer le service de motos-taxis à Bangkok et certains quartiers ont été « nettoyés ». Mais selon les données de l’AMTT, un tiers des motostaxis qui sillonnent la ville ne sont toujours pas enregistrées auprès du Département des transports (DLT) et travaillent avec des cartes d’identification photocopiées.
La même autorité appelle actuellement le gouvernement militaire à interdire des applications mobiles comme Uber ou Grab, arguant que les véhicules utilisés pour offrir ces services de transport ponctuels par des particuliers ne sont ni enregistrés, ni assurés, et que le système de paiement mis en place ne respecte pas la loi thaïlandaise. De son côté, Luksika a choisi de rejoindre GoBike, l’application de motos-taxis officielle qui a récemment reçu l’approbation du DLT. « Avec un peu de développement et une meilleure couverture, GoBike pourrait être un bon complément et une activité plus sûre, estime Luksika. Spécialement pour les femmes, qui n’auraient plus à attendre dans la file sur le trottoir toute la journée. Nous pourrions aller chercher directement les clients chez eux. Ca m’intéresse car j’ai l’intention de conduire une moto-taxi pendant toute ma vie professionnelle. »
« Un P’win meurt jeune mais vit libre.»
De retour à On Nut, Kamokwan est moins enthousiaste. « Nous inhalons tellement de pollution. Je garde toujours à l’esprit les risques pour ma santé. Tous les mois, je vais à l’hôpital pour passer des tests respiratoires. » Les P’win gagnent entre 20 000 et 25 000 bahts par mois, soit 700 à 800 bahts par jour – plus du double que ce qu’ils toucheraient avec un poste à l’usine. Mais gagner de l’argent rapidement a un prix. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la Thaïlande est le deuxième pays au monde en terme de mortalité routière après la Libye, avec un taux de 37 décès par 100 000 habitants et une estimation à près de 25 000 morts par an sur les routes du royaume. Près de trois quarts des victimes d’accidents de la route en Thaïlande sont des conducteurs ou passagers de deux-roues. Toutes les conductrices de moto-taxi rencontrées ont déjà eu un ou plusieurs accidents. Si leurs véhicules sont pour la plupart du temps assurés, les chauffeurs sont seulement couverts par le fonds informel de la file, qui reste insuffisant s’ils se trouvent en incapacité de travailler pour une période prolongée.
Comme tant d’autres secteurs, les conductrices de moto-taxi sont aux prises avec le paradoxe inhérent à l’entrepreneuriat : finie la hiérarchie oppressante, mais plus de droits collectifs du travailleur ni de sécurité à long terme non plus. Les Thaïlandais et Thaïlandaises sont de plus en plus attirés par ce statut. Mais dans une société où tout le monde est son propre patron, l’Etat et les entreprises privées se trouvent délivrés de l’obligation de remplir leurs responsabilités sociales.
La Professeure Kusakabe s’inquiète d’une érosion de la situation des femmes du pays: « Les Thaïlandaises ont bénéficié de décennies d’indépendance économique. Elles possèdent des terres. Les usines et entreprises préfèrent employer des femmes parce qu’elles sont considérées plus fiables que les hommes. Par rapport à leurs consoeurs dans la plupart des autres pays asiatiques, elles sont en bonne position. Mais elles sont susceptibles de perdre ces avantages si le marché de l’emploi se rétrécit et si un programme social n’est pas bientôt développé, comme des solutions de garde pour leurs enfants. » Sous une tente de la file d’On Nut, Somlit Lalert appelle à davantage de reconnaissance des P’win : « Nous voudrions avoir accès aux mêmes avantages sociaux que les fonctionnaires. Après tout, nous fournissons un service public. »