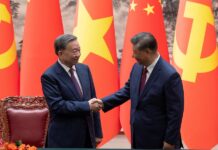La dispersion, lundi à Bangkok, d’une nouvelle vague de manifestants par l’armée Thaïlandaise ne mettra pas fin à la crise. Seul le retour de la confiance dans les institutions peut ouvrir la voie à une solution négociée. Sur la base d’une unité nationale retrouvée.
Nombreux sont les Thaïlandais convaincus que le destin de leur pays est en train de déraper. Tous, peu ou prou, avancent trois craintes à propos de cette « descente aux enfers » : l’hyper-polarisation de la société, dans un royaume habitué à la cohésion nationale ; la fracture de plus en plus visible au sein des forces de l’ordre et de l’armée, qui au cours de l’histoire moderne du pays ont souvent servi d’ultime recours ; et le combat à mort des chefs au sommet, entre l’ancien premier ministre et milliardaire Thaksin Shinawatra en exil (soutenu par les « rouges ») et ses adversaires les plus résolus tels l’influent conseiller du roi Prem Tinsulanonda, l’ancien politicien Chamlong Srimuang ou l’homme d‚affaires – controversé lui aussi – Sonthi Limthongkul, piliers de la contestation « jaune ».
Ces citoyens et ces électeurs, effrayés par l’engrenage de violence et de règlements de compte, sont malheureusement aujourd’hui dans l’incapacité de se faire entendre. D’abord parce que la plupart vivent et disposent de relais à Bangkok, désormais prise en otage par le duel entre «Rouges» et «Jaunes». Plus les semaines passent et plus l’élite de la capitale se fractionne, aspirée par l’un ou l’autre camp. Les « médiateurs » possibles ont quasi-disparu. Les généraux de l’armée et de la police fourbissent leurs armes en prenant soin de ne pas compromettre leur future carrière.
Au piège qu’est devenu Bangkok s’en ajoute un autre: la perte de confiance vertigineuse dans les institutions du pays. Le parlement, traditionnellement décrié en raison des magouilles électorales et des revirements d’alliance, a perdu toute légitimité, malgré le soutien apporté par une majorité d’élus à l’actuel premier ministre Abbhisit Vejjajiva, en poste depuis décembre. Les juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, appelés à la rescousse pour bouter hors du pays et du paysage politique l’ancien chef du gouvernement Thaksin Shinawatra, coupable avéré de malversations, sont présumés par les uns et les autres à la solde du pouvoir en place. L’armée, discréditée par le dernier coup d’Etat de septembre 2006 qui renversa Thaksin mais ne parvint pas à remettre le pays sur les rails, apparaît dépassée par les événements. Et le comportement du Roi Bhumipol et de son entourage, plus que jamais clef de voute du pays, est ouvertement questionné. Les fissures, sans être irrémédiables, sont de plus en plus profondes.
La seule façon d’en sortir – autre qu’un nouveau bain de sang – est donc de ramener, chez les « jaunes » comme chez les « rouges », mais aussi au sein de la communauté internationale, un début de confiance dans l’Etat Thaïlandais qui fait aujourd’hui tant défaut. Sur la base d’une unité nationale retrouvée, d’un calendrier politique, et de concessions mutuelles qui, pour être acceptées, devraient être avalisées d’en haut, c’est-à-dire sans doute par le souverain lui-même.
La première étape, aussi contestable soit-elle au vu de ses malversations passées, est d’offrir à l’ex-premier ministre Thaksin Shinawatra une porte de sortie négociée. Ex-colonel de police, devenu milliardaire dans le secteur des télécommunications grâce à quelques solides contrats arrachés en parfaite violation des règles de concurrence, celui-ci a montré qu’il était prêt au pire – y compris à compromettre l’intégrité de l’Etat – pour défendre sa fortune aujourd’hui en passe d’être confisquée. Il démontre aussi, ces jours-ci, sa capacité de nuisance persistante en exil, bien que sous le coup de poursuites internationales. En bref, l’homme est trop dangereux, trop prêt à tout pour être ignoré. Une trêve doit lui être proposée, via sans doute des tractations secrètes. Comme avec tout parrain mafieux.
La seconde étape doit consister à proposer aux leaders des « jaunes » un rôle dans la surveillance de ce processus de déminage politique à haut-risque. Comment ? C’est au gouvernement Thaïlandais d’en décider. Des idées, utilisées sous d’autres latitudes, comme la création d’une conférence de réconciliation nationale ne doivent pas être écartées. Autre scénario : la formation d’un parti politique « jaune », ou l’intégration de quelques-uns de ses meneurs dans l’influent cénacle des conseillers du roi. Bref, les « jaunes » ne doivent pas se sentir dépossédés. Leur fronde, largement suivie à Bangkok, contre les abus intolérables des années Thaksin a engendré une légitimité dont il faut tenir compte.
Le troisième volet de ce processus, de loin le plus difficile, pourrait être d’impliquer la communauté internationale. Que les Thaïlandais le veuillent ou non, leur pays n’est plus ces temps-ci celui du « sourire ». Cela ne veut pas dire qu’il est dangereux d’y séjourner ou d’y résider. Cela ne veut pas dire que le droit n’y est pas respecté, ou qu’il n‚est plus possible d’y faire des affaires. Cela veut dire q’‚un noeud institutionnel et politique pour l’heure inextricable doit être dénoué.
Or des médiateurs internationaux ont su, dans d’autres situations, faire leurs preuves. Le Royaume-Uni n’a pas craint, pour régler le conflit nord-irlandais, de faire appel à l’aide d‚un sénateur Américain. L’Indonésie, pour régler la question d’Aceh, a profité de l’expertise d’un ancien président Finlandais. Il ne s’agit là, ni de placer la Thaïlande sous tutelle, ni de remettre les compteurs à zéro. Il s’agit de rouvrir la voie du dialogue aujourd’hui très étroite et tachée de sang. S‚y refuser, sous prétexte de souveraineté nationale exacerbée et alors que M. Shinawatra se trouve à l’étranger, pourrait s’avérer, à terme, une erreur couteuse.
Richard Werly