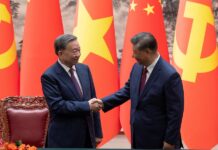L’émergence des thaïs dans la région, leur émancipation progressive de la tutelle khmère, et la création de plusieurs royaumes rivaux (Sukhothai, Lan Na, Lan Chang), nous nous tournons aujourd’hui à travers cette chronique de Xavier Galland vers le royaume d’Ayutthaya qui, pendant un peu plus de quatre cents ans – approximativement de la Peste noire (plus ou moins 1348-1350) à la dernière décennie du règne de Louis XV (mort en 1774) – sut enrichir et développer cet héritage dont il est dépositaire.
Le mardi 7 avril 1767, après un siège de plus d’un an, Ayutthaya tombe aux mains des Birmans de Hsinbyushin.
C’est à l’époque une ville que les voyageurs européens décrivent avec admiration et qu’ils estiment plus grande et plus peuplée que Londres ou Paris. Parsemée de plusieurs centaines d’édifices religieux et entourée d’une enceinte de plus de dix kilomètres de long percée d’innombrables portes et le long de laquelle s’échelonnent une quinzaine de fortins, Ayutthaya s’articule autour de rues, dont beaucoup sont pavées, et de canaux qu’enjambent une trentaine de ponts. Les ressortissants de nombreux pays – Chine, Cambodge, Laos, Aceh (nord de Sumatra), Banten (ouest de Java), Makassar (ouest de Sulawesi), Golconde et Bengale (Inde), Perse, Japon, Portugal, Espagne, Hollande, Danemark, Angleterre et, bien sûr, France – s’y côtoient et s’y livrent au commerce et au prosélytisme religieux. Beaucoup de ces groupes disposent de leurs quartiers propres.
Ayutthaya conquise, les Birmans mettent la ville à sac et s’appliquent à faire table rase du passé siamois. Viols, saccages, pillages, déprédations se succèdent à l’envi et ni les temples ni les lieux sacrés ne sont épargnés. Les statues de Bouddha sont dépouillées de l’or qui les revêt, les objets de valeur sont emportés, les bâtiments officiels et administratifs mis à bas, la ville incendiée et rasée. Des milliers de prisonniers sont rassemblés et envoyés en Birmanie. Le roi, Borommaracha V (alias Suriyamarin, alias Ekkathat), quant à lui, s’est enfui. Il mourra peu après. De la ville, il ne reste alors plus qu’une carcasse qui, pendant plusieurs mois, est hantée par des bandes de brigands et de maraudeurs, disputant la dépouille de cette splendeur passée à de rares survivants, livrés à la famine et aux maladies.
Il faut imaginer cette soldatesque, frustrée par des mois de sièges, pouvant enfin donner libre cours à ses pulsions et étancher consciencieusement sa soif de vandalisme et d’anéantissement de l’ennemi exécré… L’histoire humaine fournit, hélas, de trop nombreux exemples de tels carnages.
La destruction d’Ayutthaya ne marque pas seulement la fin d’une ville mais celle d’une époque. Les archives historiques, juridiques, administratives, militaires ont disparu et, avec elles, une partie de la mémoire nationale. Seules quelques rares œuvres littéraires ont échappé au cataclysme.
Que nous reste-t-il donc aujourd’hui qui nous permette de connaître ce royaume, sa capitale, son histoire ? Plusieurs sources sont à notre disposition. Beaucoup sont d’origine non thaïe et, pour cette raison, ont échappé à la destruction.
Une bonne partie de nos connaissances relatives au royaume d’Ayutthaya provient donc de textes étrangers : relations de voyages et/ou de séjours, correspondances commerciales, rapports d’ambassades, compte-rendus de missions religieuses, tentatives de compilation d’une histoire du royaume, récits d’événements historiques précis, etc. À ces textes viennent s’ajouter les chroniques officielles birmanes – dont la célèbre Chronique du Palais de cristal – qui, elles, bien sûr, n’ont pas été détruites (d’autant moins que la Chronique du Palais de cristal date de 1829).
Enfin, il subsiste encore certaines archives siamoises, toutes n’ayant pas disparu lors de l’annihilation de la ville. Les premiers rois post-Ayutthaya rassemblèrent ce qu’ils purent des chroniques anciennes qui avaient échappé à la destruction mais ces collections elles-mêmes ont de nos jours disparu. Seules sept versions principales subsistent aujourd’hui – datées de 1680 pour la plus ancienne et de 1855 pour la plus récente (1779, 1795 et 1807 pour celles des autres dont la date est connue) -, ainsi que quelques fragments épars. Il va sans dire que ces sources ne sont pas forcément impartiales, tant s’en faut, et qu’il convient de toujours les comparer et de vérifier et recouper leur contenu. Mais n’est-ce pas là précisément le travail de base de l’historien ?
Xavier Galland
Chronique historique publiée en septembre 2010.